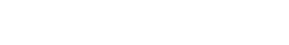La chapelle – 3B Scientific Anthropological Skull Model - La Chapelle-aux-Saints User Manual
Page 6

®
Français
La Chapelle
• Désignation exacte : La Chapelle-aux-Saints
• Homo (sapiens) neanderthalensis (Néandertalien classique ou Néandertalien tardif)
• Groupe : Néandertaliens
Le modèle a été développé d'après un moulage de la reproduction originale de la collection de l'université Johann
Wolfgang Goethe à Francfort-sur-le-Main, institut d'anthropologie et de génétique humaine pour biologistes.
Le crâne de La Chapelle fut découvert en 1908 en Dordogne, dans le sud de la France. Il s‘agit là du crâne d‘un
homme qui était à l‘époque âgé entre 50 et 55 ans. Comme la plupart des crânes de Néandertaliens européens
de la dernière période glaciaire, il s‘agit d‘un grand crâne, ce qui s‘applique aussi bien à la boîte crânienne qu‘au
crâne facial (seule la hauteur crânienne est faible). Chez les Néandertaliens adultes, la longueur crânienne con-
sidérable dépasse toujours plus de 190 mm, dans la plupart des cas, elle est de plus de 200 mm. Dans le cas
du crâne de La Chapelle, la longueur du crâne la plus grande atteint même 208 mm. Ces valeurs se situent en
moyenne bien au-delà de celles de l‘homme récent. La largeur crânienne est surtout importante dans la région
moyenne bien au-delà de celles de l‘homme récent. La largeur crânienne est surtout importante dans la région
frontale et le pourtour horizontal crânien est de 590 à 600 mm (cette dernière valeur citée s‘applique également
frontale et le pourtour horizontal crânien est de 590 à 600 mm (cette dernière valeur citée s‘applique également
au crâne de La Chapelle). La capacité de la boîte crânienne dépasse généralement 1500 cm
au crâne de La Chapelle). La capacité de la boîte crânienne dépasse généralement 1500 cm
3
, celle de ce crâne est
de 1620 cm
3
. Comparé à l‘homme récent, le crâne est bas à mi-haut. Compte tenu de la longueur considérable, il
. Comparé à l‘homme récent, le crâne est bas à mi-haut. Compte tenu de la longueur considérable, il
est cependant extrêmement bas.
Les arcades sourcilières (Tori supraorbitales) constituent une saillie osseuse proéminente suivie d‘un front fuyant.
Les arcades sourcilières (Tori supraorbitales) constituent une saillie osseuse proéminente suivie d‘un front fuyant.
Les arcades sourcilières (Tori supraorbitales) constituent une saillie osseuse proéminente suivie d‘un front fuyant.
Les arcades sourcilières (Tori supraorbitales) constituent une saillie osseuse proéminente suivie d‘un front fuyant.
Les arcades sourcilières des Néander-taliens ne sont pas en rapport phylogénétique avec celles des anthropoïdes
Les arcades sourcilières des Néander-taliens ne sont pas en rapport phylogénétique avec celles des anthropoïdes
Les arcades sourcilières des Néander-taliens ne sont pas en rapport phylogénétique avec celles des anthropoïdes
Les arcades sourcilières des Néander-taliens ne sont pas en rapport phylogénétique avec celles des anthropoïdes
mais doivent être considérées en tant que convergences, ce qui résulte de la localisation des sinus frontaux (Sinus
mais doivent être considérées en tant que convergences, ce qui résulte de la localisation des sinus frontaux (Sinus
mais doivent être considérées en tant que convergences, ce qui résulte de la localisation des sinus frontaux (Sinus
mais doivent être considérées en tant que convergences, ce qui résulte de la localisation des sinus frontaux (Sinus
frontalis). En effet, chez le singe, ils sont toujours situés derrière le Torus alors que chez le Néander-talien, ils rem-
frontalis). En effet, chez le singe, ils sont toujours situés derrière le Torus alors que chez le Néander-talien, ils rem-
frontalis). En effet, chez le singe, ils sont toujours situés derrière le Torus alors que chez le Néander-talien, ils rem-
frontalis). En effet, chez le singe, ils sont toujours situés derrière le Torus alors que chez le Néander-talien, ils rem-
®
®
frontalis). En effet, chez le singe, ils sont toujours situés derrière le Torus alors que chez le Néander-talien, ils rem-
plissent l‘arcade. Contrairement à d‘anciennes théories, le Sinus frontalis n‘a pas de signification phylogénétique.
plissent l‘arcade. Contrairement à d‘anciennes théories, le Sinus frontalis n‘a pas de signification phylogénétique.
plissent l‘arcade. Contrairement à d‘anciennes théories, le Sinus frontalis n‘a pas de signification phylogénétique.
plissent l‘arcade. Contrairement à d‘anciennes théories, le Sinus frontalis n‘a pas de signification phylogénétique.
®
®
plissent l‘arcade. Contrairement à d‘anciennes théories, le Sinus frontalis n‘a pas de signification phylogénétique.
Vu latéralement, l‘occiput a un aspect aplati et étiré et la vue occipitale ressemble à un ovale à arrondi élargi.
Vu latéralement, l‘occiput a un aspect aplati et étiré et la vue occipitale ressemble à un ovale à arrondi élargi.
Vu latéralement, l‘occiput a un aspect aplati et étiré et la vue occipitale ressemble à un ovale à arrondi élargi.
Vu latéralement, l‘occiput a un aspect aplati et étiré et la vue occipitale ressemble à un ovale à arrondi élargi.
L‘apophyse mastoïde du temporal est petite. Le crâne facial, comparé à celui de l‘homme récent, donne
L‘apophyse mastoïde du temporal est petite. Le crâne facial, comparé à celui de l‘homme récent, donne
L‘apophyse mastoïde du temporal est petite. Le crâne facial, comparé à celui de l‘homme récent, donne
L‘apophyse mastoïde du temporal est petite. Le crâne facial, comparé à celui de l‘homme récent, donne
l‘impression d‘être extrêmement grand, ce qui résulte entre autres de la largeur considérable des os malaires (153
l‘impression d‘être extrêmement grand, ce qui résulte entre autres de la largeur considérable des os malaires (153
l‘impression d‘être extrêmement grand, ce qui résulte entre autres de la largeur considérable des os malaires (153
l‘impression d‘être extrêmement grand, ce qui résulte entre autres de la largeur considérable des os malaires (153
mm). Les cavités orbitaires larges et hautes sont davantage arrondies sur le bord supérieur et les fosses nasales
mm). Les cavités orbitaires larges et hautes sont davantage arrondies sur le bord supérieur et les fosses nasales
sont élevées et larges. Les os du nez sont dirigés dans le sens vestibulaire. Une fosse molaire dans le maxillaire
supérieur, qui est typique pour l‘homme récent et que l‘on trouve déjà sur le crâne de Steinheim, est absente
chez tous les Néandertaliens classiques. Pour les maxillaires inférieurs longs très développés à menton fuyant, les
branches montantes sont, comme chez le Homo Erectus, très écartées. Dans la plupart des cas, les dents sont plus
grandes que celles de l‘homme récent.
L‘âge du crâne de La Chapelle est supposé se situer entre 35 000 et 45 000. Toutefois, il n‘a pas encore été déter-
miné avec précision. Globalement, la majorité des découvertes de Néandertaliens européens est datée entre 60
000 et 35 000 ans (Oakley).
La question du lien de parenté entre l’homme de Neandertal et l’homme moderne est encore toujours discutée
de façon controversée. Alors que les représentants d’un «modèle de remplacement» strict prônent un propre
statut d’espèce (Homo neanderthalensis), les représentants du développement multirégional de l’Homo sapiens
considèrent un mélange et, par conséquent, voient le modèle biologique des espèces, le statut de l’homme de
Neandertal comme sous-espèce (Homo sapiens neanderthalis). Les résultats génétiques les plus récents semblent
plaider en faveur des partisans du «remplacement» et, par conséquent, d’un statut d’espèce propre ; des doutes
considérables ont cependant été exprimés quant à l’interprétation de ces résultats. Une réponse unanime à la
« controverse de l’homme de Neandertal » ne semble pas encore être à portée de main.
Dans cette présente reconstitution, les fragments osseux fossiles qui n‘étaient pas présents au moment de la
découverte d‘origine ont été représentés en brun. Les parties représentées en couleur grise indiquent les emplace-
ments qui ont été complétés sur l‘original ou qui servaient de masse d‘adhérence pour assembler chaque partie.
Auteur : Dr. sc. Arthur Windelband, Université Humboldt de Berlin
Remanié en 2004 par Monsieur Stefan Flohr, collaborateur de l'Université Johann Wolfgang Goethe à Francfort-sur-le-Main